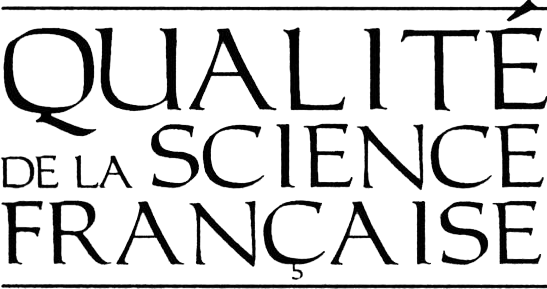Tout va très bien, Madame la marquise
Le 18 mars dernier, la Conférence des présidents d’universités (CPU) a tenu une conférence de presse dont l’objectif était notamment de présenter les résultats d’une « étude flash » sur les résultats de la session d’examen du premier semestre de l’année 2020-2021.[1]
Lors de cette conférence de presse, rien n’a apparemment été dit de la méthodologie de l’étude, de sa représentativité, ni même des résultats précis recueillis qui sont résumés dans des graphiques pour le moins obscurs. Mais le message délivré par Guillaume Gellé, président de l’université de Reims et vice-président de la CPU est clair : d’une part, la participation aux examens est stable : « tous les résultats confirment une stabilité de la participation aux examens, voire, dans certains cas, une légère hausse » ; d’autre part, en première année, les résultats sont, également, « globalement stables » par rapport aux années antérieures. Guillaume Gellé explique ces bons résultats par « l’attention particulière apportée par les équipes pédagogiques » à cette population, qui a été fragilisée par les conditions d’achèvement de sa scolarité secondaire (confinement du printemps 2020) et celles de son entrée à l’université (mesures restrictives et confinement de l’automne 2020 et de l’hiver 2021).
Lors de cette conférence de presse, Manuel Tunon de Lara, président de l’université de Bordeaux, esquisse toutefois l’idée qu’il faudrait, dans ces apparents bons résultats, distinguer « la part de mansuétude de jury et la part de l’accompagnement plus spécifique ». De même, François Germinet, président de l’université de Cergy-Pontoise reconnaît que « sur les années intermédiaires », on a observé « à certains endroits du retard », « qu’un bout de cours n’ait pas pu être fait » et que l’examen ait pu porter sur « 80 % du programme ». Il tempère : « Dire qu’en L1 et L2, il n’y a pas de décrochage massif ne signifie pas que tout va bien. Ce que nous disons, c’est que ça se tient, les étudiants s’accrochent, il n’y a pas péril en la demeure ». Finalement, Guillaume Gellé rassure par une pétition de principe : « les universités n’ont pas intérêt à brader leurs diplômes » et souligne que « la qualité d’un diplôme s’observe sur un ensemble de semestres et [que] l’exigence des jurys est toujours plus forte pour les années terminales ». En somme, le contexte a probablement généré un peu de laxisme qui sera rattrapé au cours des années ultérieures. Il conclut finalement que les jurys « humains et souverains, sont capables d’appréhender une situation. Ils ont bien fait leur travail ».
Une telle phraséologie laisse rêveur. Rappelons les faits. Après une année scolaire considérablement perturbée par la crise épidémique, le baccalauréat 2020 a connu des records de réussite : 95,7 % au total contre 88,1 % en 2019. Pour le baccalauréat général, le taux de réussite était de 98,4 % contre 91,2 en 2019. On se demande en quoi il peut être encore utile de faire passer un tel examen. Il ne faut même pas compter sur les mentions pour départager les candidats, puisque 63,5 % d’entre eux (contre 47 % en 2019) en ont obtenu une. Pour le baccalauréat général, le taux de mention s’élève même à 69,5 %. On s’est donc inquiété lors de la proclamation de ces résultats des conséquences qu’ils ne pourraient manquer d’avoir sur la première année universitaire. Les universités, chargées d’accueillir la population qui n’a pas trouvé de place dans les filières sélectives allaient être contraintes de prendre en charge en plus grand nombre des élèves, moins bien formés au lycée du fait de l’interruption des cours, perturbés dans leurs repères scolaires et leurs habitudes de travail, et moins triés que jamais par l’examen de fin d’études secondaires.
Comme on pouvait s’en douter, l’épidémie a repris à l’automne, ce qui a imposé de restreindre l’accès aux universités, puis de les fermer totalement. Pendant plusieurs semaines, les projecteurs médiatiques ont alors été braqués sur la souffrance des étudiants, empêchés de suivre leurs enseignements « en présentiel », pas ou mal équipés pour les moins fortunés d’entre eux en équipements informatiques pour suivre des enseignements « en distanciel », lesquels sont jugés par la plupart des commentateurs pédagogiquement insatisfaisants. L’affaire était claire : les étudiants « décrocheraient » en masse, au point que le président de la République, en pleine phase de recrudescence de l’épidémie demandait, dans un discours tenu sur le campus de Saclay le 21 janvier 2021, la réouverture partielle des campus !
Dans un tel contexte, objectivement catastrophique, les résultats du premier semestre de l’année 2020-2021, équivalents, voire parfois meilleurs que ceux des années précédentes, sont une divine surprise ! L’investissement des universités et des équipes pédagogiques aurait finalement permis qu’en dépit des graves difficultés rencontrées, les étudiants soient mieux accompagnés que jamais dans leur parcours universitaire. Certes, lors de leur conférence de presse, les Présidents interrogés reconnaissent à mots couverts que peut-être il y aurait eu, ça et là, quelques faiblesses dans l’évaluation, mais l’effondrement tant redouté ne s’est pas produit. Ces petites imperfections seront facilement réparées dans les années qui suivent et l’université française sortira de la crise, plus forte que jamais.
Comment, face à un tel discours, ne pas avoir le sentiment de vivre au pays de l’avenir radieux, ainsi qu’Alexandre Zinoviev décrivait l’empire soviétique finissant. Comme dans l’URSS brejnevienne, personne n’est dupe, mais il faut garder la face et faire tenir l’imagerie, si ce n’est l’illusion. Il n’est pas difficile de conclure en effet que ce qui s’est passé lors des examens de première année universitaire est similaire à ce qui s’est passé lors du baccalauréat. Dans l’incapacité d’évaluer effectivement les candidats, le doute leur profite. Et ce fut le cas déjà aussi lors des examens de licence (première, deuxième, troisième année) au printemps 2020. Dans bien des établissements et des disciplines, les examens n’ont pour beaucoup pas pu être organisés de façon conventionnelle. Ils ont été remplacés par des « travaux personnels » des étudiants ou par des examens organisés à distance, sans aucun contrôle possible. Chez eux, les étudiants peuvent avoir accès à toute la documentation à leur disposition, ce qui n’est pas en soi un problème si les sujets d’examen sont bien pensés. Mais ils peuvent aussi librement communiquer entre eux, pour se transmettre les bonnes idées, comme les mauvaises. C’est assurément dans les sciences humaines et sociales que le problème est le plus grave. On est tenté d’accuser le laxisme des enseignants, qui, par faiblesse morale et/ou par idéologie, refuseraient de sanctionner les étudiants, qu’ils considèreraient comme des victimes sociales. Ce jugement sévère n’est pas totalement dénué de fondement, mais n’explique pas tout. C’est la nature même des exercices exigés par ces disciplines qui rend plus difficile qu’ailleurs une évaluation pertinente dans un tel contexte d’examen.
L’expérience d’un universitaire ordinaire
Aux beaux propos des présidents d’université et à leurs statistiques obscures, je ne peux opposer que ma modeste expérience d’universitaire ordinaire. Je n’ai pas donné cette année de cours en première année, mais seulement en deuxième année. Il était délivré dans un cursus de sciences politiques, c’est à dire dans une UFR de Droit. On m’avait annoncé, au vu de l’expérience des années antérieures, un effectif de 120 étudiants. J’en ai eu en fait 160 du fait de la croissance des effectifs consécutive au caractère non-discriminant des examens de fin de première année 2020. J’ai assuré quelques cours présentiels en « demi-jauge », c’est-à-dire dans une salle pleine à 80 % puisque celle que l’on m’avait affectée ne pouvait contenir plus d’une centaine d’étudiants. Quand mon cours est passé en « distanciel », ce ne sont pas plus de 50 à 60 étudiants qui se sont connectés chaque semaine. Lors de l’examen, en revanche, ce sont bien 160 étudiants qui ont composé et aucun n’a rendu copie blanche. En quarante et un an d’expérience d’enseignement universitaire, je n’avais jamais connu telle participation !
Que conclure ? Que rien ne freine la participation aux examens en distanciel. Il n’y a pas à faire l’effort de se rendre sur le campus et on peut toujours remplir une copie, ne serait qu’en recopiant celle transmise par courrier électronique par un camarade. Ma longue expérience universitaire m’a appris à composer des sujets tels que la « triche » m’indiffère. Les étudiants peuvent bien se transmettre des informations pendant l’épreuve, tirer des « anti-sèche » du fond de leur poche, voire consulter clandestinement internet, cela n’aura pas de conséquences sur leur capacité réelle à répondre aux questions que je leur pose. Je ne suis pas là pour juger leur moralité, mais leurs compétences. S’ils sont capables de faire un usage intelligent (et discret) de méthodes que la morale scolaire réprouve, tant mieux pour eux. Mais, en cette occasion, pour la première fois de ma carrière, je me suis trouvé face à des difficultés d’évaluation insurmontables. Les échanges que j’ai eus avec les étudiants après le rendu des notes m’ont montré que la source de leurs copies était un document élaboré plus ou moins collectivement entre eux sur un site en ligne, censé être mon cours. Celui-ci a fonctionné comme un multiplicateur d’âneries à un niveau inégalé.
Je ne suis pourtant pas de ceux qui considèrent que l’enseignement à distance serait impossible. J’ai réussi à faire travailler de façon satisfaisante des étudiants de master, même si une large partie d’entre eux était d’un niveau médiocre et parfois réticents face à l’investissement personnel que j’exigeais d’eux. Les conditions de félicité d’un enseignement en distanciel ne sont pas très différentes de celles d’un enseignement en présentiel : un effectif qui ne dépasse pas quinze à vingt étudiants. Mieux que dans une salle de classe, on peut alors s’assurer que chacun prépare la séance et y intervient. Je m’y suis attelé. Je considère en revanche que les grands cours d’amphithéâtre sont devenus une absurdité, en présentiel comme en distanciel. Ils visaient à faire profiter de larges masses d’auditeurs d’une information rare possédée par les seuls enseignants. Aujourd’hui, l’information est surabondante et accessible à tous. Si l’enseignant peut servir à quelque chose, c’est à guider les étudiants, en leur apprenant à chercher les bonnes sources, à les comparer, à les discuter. La permanence du cours classique résulte selon moi d’un « pacte de paresse » entre les enseignants et les étudiants. Les étudiants ont pour seules obligations d’ingurgiter la parole du maître à moindre frais cognitif dans une salle de classe et de la régurgiter de même sur la copie. Ils peuvent rester étrangers à leur formation et n’y voir qu’un jeu scolaire sans lien avec la vie réelle.
Les examens traditionnels, sur table, permettent difficilement, en sciences humaines et sociales, au moins, de juger de la qualité réelle de l’étudiant. Mais ils témoignent toutefois d’un engagement minimal dans les études. Pour les réussir, ils ont dû suivre le cours, le noter, l’apprendre et prendre la peine de venir composer. C’est, de fait, cet engagement minimal et lui seul qui est aujourd’hui évalué en cycle de licence dans les universités françaises. C’est tellement vrai que le fameux taux d’échec régulièrement dénoncé correspond massivement, non à des résultats inférieurs à la moyenne requise, mais à des « défaillances », c’est-à-dire aux cas d’étudiants qui n’ont pas passé tous les examens, voire qui n’en ont passé aucun et auxquels les universités, quelque effort qu’elles aient fait pour composer les règlements d’examen les plus favorables possibles, ne peuvent délivrer le diplôme. C’est ce minimum minimorum de l’engagement étudiant qui a disparu avec l’examen à distance. En clair, on ne contrôlait déjà pas grand-chose ; on ne contrôle aujourd’hui plus rien.
L’inflation universitaire
Faisons le bilan. Les universités sont chargées de recevoir en première année le public qui n’a pas trouvé de place ailleurs. Son public est donc le produit d’une anti-sélection. Traditionnellement, on considérait que la contrepartie de cette absence de sélection à l’entrée était une sélection en cours de cursus. Celle-ci s’opérait essentiellement par l’abandon des études et beaucoup moins qu’on ne le croit par l’échec stricto sensu. On pouvait donc retrouver jusqu’à un niveau avancé du cursus des étudiants dépourvus des bases élémentaires, ne serait-ce que de la capacité de rédiger une copie en français standard. Certes, depuis 2017, une sélection est opérée pour l’accès en cycle de master, mais le manque de candidats dans certaines formations et la pression exercée pour offrir à tous un cycle complet d’études conduisent à ce que des étudiants gravement déficients puissent parfois accéder à un tel niveau. L’épidémie de Covid a désorganisé le lycée en 2020 et il va en être de même en 2021. Elle a désorganisé aussi les examens universitaires. Les universités vont donc devoir gérer des cohortes importantes d’étudiants faiblement engagés dans leurs études, jamais véritablement évalués et auxquels il sera difficile assurément d’interdire l’accès en master …
On pourra alors sortir des statistiques avantageuses sur le pourcentage d’une classe d’âge atteignant les niveaux bac + 3 (licence), bac + 5 (master). Les malheurs publics peuvent avoir des conséquences inattendues. La présente épidémie va faciliter miraculeusement l’atteinte des objectifs du Gosplan de la société de la connaissance. La machine à diplômer va fonctionner à plein régime, parallèlement à la machine à billets qui a été utilisée pour faire face à la crise. Les économistes nous expliquent que, dans le présent contexte, le risque d’inflation monétaire est réduit. Le risque d’« inflation scolaire » est, quant à lui, certain. Cette inflation diplômante n’a pas en soi de caractère dramatique, si on admet la variation des valeurs relatives des diplômes : une licence n’a pas aujourd’hui une valeur sociale différente de celle que possédait un baccalauréat il y a encore une vingtaine d’années. Mais comme la population admet difficilement cette relativité, l’excès de diplomation produit de la frustration sociale. Par ailleurs, ce processus a deux autres conséquences. La première est le hiatus le plus en plus grand entre l’attente des étudiants et celle des enseignants, statutairement aussi chercheurs, que l’on met en face d’eux, ce qui provoque une souffrance réciproque. La deuxième est due au fait que la hiérarchisation de l’enseignement supérieur français ne s’organise pas exclusivement en strates temporelles (bac + 3, + 5), mais aussi par filières : sélectives et non-sélectives. L’affaiblissement de l’enseignement non-sélectif public (l’université) profite donc au secteur sélectif, c’est-à-dire, de plus en plus, au secteur privé ou semi-privé, celui où l’on peut à la fois sélectionner le public et lui faire payer les diplômes qu’on lui délivre. Par démagogie, on est en fait en train de rendre l’enseignement supérieur français plus injuste socialement qu’il ne l’a jamais été.
J’ai déjà à maintes reprises tenté d’expliquer ce mécanisme infernal. J’entends seulement souligner ici que le contexte dû à la présente épidémie ne peut que l’accélérer. Dans ce domaine, comme dans tant d’autres, cette épidémie fonctionne comme un formidable révélateur de tendances profondes et anciennes. On pourrait se dire qu’il ne s’agit que d’un épisode difficile qui pourra être surmonté. Il est plutôt à craindre qu’il ne soit plus possible de remettre les verrous qui auront sauté. Imagine-t-on qu’après avoir « donné » le baccalauréat à la quasi-totalité des candidats en 2020 et 2021, on puisse revenir en arrière ? Il en sera de même dans l’université. Notre institution était trop faible pour pouvoir résister à un tel coup de boutoir. Nous en paierons longtemps le prix.
[1] Je m’appuie sur le seul document disponible à ma connaissance : le compte-rendu de cette conférence de presse par Catherine Buyck et Camille Mordelet sur le site AEF-info : https://www.aefinfo.fr/depeche/648602-reussite-aux-examens-des-taux-similaires-a-lan-passe-en-licence-parfois-en-baisse-en-master-enquete-de-la-cpu.